Réformes et vision du monde : contre la technicisation et la dépolitisation des débats sur l’université
Ecrit par Igor Babou, 3 Fév 2009, 0 commentaire
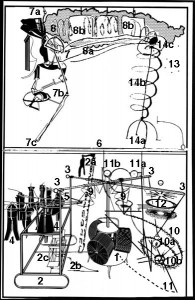 Si les débats autour de l’université et de la recherche sont si passionnés, c’est qu’ils ne se résument en aucun cas à des revendications corporatistes. En arrière plan des “réformes” en cours, il y a des visions du monde et des choix de société.
Si les débats autour de l’université et de la recherche sont si passionnés, c’est qu’ils ne se résument en aucun cas à des revendications corporatistes. En arrière plan des “réformes” en cours, il y a des visions du monde et des choix de société.
Si je suis attaché à mon métier d’universitaire, c’est parce qu’il porte justement des conceptions du monde et du rapport aux autres. Disons, pour faire court, quelque chose qui a à voir avec l’humanisme et que les régimes autoritaires et bureaucratiques, de droite comme de gauche, ont toujours combattu.
C’est ça, qui est en jeu depuis quelques années à l’université, et non nos payes, notre organisation ou nos supposés avantages. Ce qui se joue, c’est la lutte entre une vision de la société comme quelque chose d’égalitaire où la connaissance est considérée comme un patrimoine et un bien PUBLIC, contre une société de la concurrence, inégalitaire, où la connaissance, transformée en marchandise, se retrouvera privatisée et mise au service de quelques privilégiés.
Je suis bien conscient que le comportement quotidien de bien des universitaires — de droite comme de gauche — n’a rien d’humaniste, et ce, depuis bien longtemps. Pour autant, il ne faut pas confondre la manière dont les individus actualisent les possibilités d’un système, et les règles de ce système. Si l’autoritarisme bureaucratique des actuelles réformes gagne, il n’y aura plus aucune place pour l’humanisme : la barbarie bureaucratique aura gagné.
Pour le moment, nous héritons encore des derniers vestiges de l’humanisme et des Lumières : un savoir n’est pas une “donnée” échangeable sur un marché, mais quelque chose de construit collectivement et mis au service, souvent gratuitement, de la collectivité, dans le contexte d’une discussion publique entre pairs (la thèse, par exemple) ayant pour objectif l’établissement d’une vérité concernant une portion délimitée du réel. C’est pour cela que nous sommes des scientifiques ET des intellectuels, et non de simples techniciens de la connaissance : nous élaborons collectivement des discours à prétention de vérité portant sur la nature, les sociétés ou les individus, en principe dans le but de contribuer à une vie plus juste.
Nous ne sommes pas les techniciens du savoir que l’actuel gouvernement envisage de nous faire devenir : nous nous posons des questions, et nous en posons à la nature, aux sociétés, à leur histoire. C’est ce qu’on appelle “la critique”.
 Un technicien du savoir, lui, sera amené à répondre à des demandes émanant du politique ou du marché : c’est bien différent. Il ne SE posera pas de question : il élaborera des réponses aveugles à leurs propres déterminations (idéologiques, politiques, économiques, etc.). Il sera “efficace”. Il obéira à des normes imposées et indiscutables. Il ne sera qu’un instrument au service du pouvoir. C’est malheureusement ce que sont déjà devenues une bonne partie des sciences de la nature, et également une partie des sciences humaines et sociales, depuis l’hyper-spécialisation disciplinaire et l’abandon de l’idéal de produire un savoir critique par une partie de l’université française, suivant en cela les injonctions des libéraux de droite comme de gauche : ce vaste mouvement de technocratisation de l’université et de la recherche a des racines anciennes.
Un technicien du savoir, lui, sera amené à répondre à des demandes émanant du politique ou du marché : c’est bien différent. Il ne SE posera pas de question : il élaborera des réponses aveugles à leurs propres déterminations (idéologiques, politiques, économiques, etc.). Il sera “efficace”. Il obéira à des normes imposées et indiscutables. Il ne sera qu’un instrument au service du pouvoir. C’est malheureusement ce que sont déjà devenues une bonne partie des sciences de la nature, et également une partie des sciences humaines et sociales, depuis l’hyper-spécialisation disciplinaire et l’abandon de l’idéal de produire un savoir critique par une partie de l’université française, suivant en cela les injonctions des libéraux de droite comme de gauche : ce vaste mouvement de technocratisation de l’université et de la recherche a des racines anciennes.
Si nos débats sont vifs, c’est parce qu’en arrière plan, c’est la transformation de toute la société française qui est en jeu. Si triomphait une conception de la recherche et de l’université comme de simple officines répondant aux besoins de l’économie, alors la société française aurait perdu ce qui fait qu’une société n’est pas seulement un assemblage temporaire d’intérêts bien compris entre des individus en concurrence pour des ressources : la capacité à élaborer une réflexivité. La capacité à SE penser. La recherche et l’enseignement supérieur, ça ne sert pas seulement à produire des brevets et à pondre des publications à la chaîne pour répondre à un dogme bureaucratique et statisticien. Ça sert à ouvrir les esprits sur le monde, à rendre les gens capables de critiquer le monde, d’en dénoncer l’état comme n’ayant rien de naturel, à montrer que les idéologies sont construites, bref, à ouvrir des possibles. C’est nettement plus utile à une société qu’un brevet OGM ou qu’une statistique de chômage. Et c’est nettement plus dangereux pour les pouvoirs autoritaires qu’une chambre à bulles ou un synchrotron.
Il y a quelque chose de profondément barbares dans les réformes en cours, et je pèse mes mots : la barbarie, c’est l’étrangeté à soi-même, à l’humanité et à la société de ceux qui croient (plaignons les !) qu’entre les humains il n’y aurait que des rapports de domination, des échelles permettant de classer tel ou tel par rapport à tel ou tel selon des critères abstraits. La barbarie libérale, c’est une pensée qui évacue les individus et les collectifs en les abstractisant, tout comme l’avait fait en son temps le communisme stalinien : les individus n’étant plus considérés que comme des instances permutables de classes abstraites, de même que les savoirs n’étant plus considérés que comme des “données” échangeables et servant le pouvoir de l’économie, la barbarie libérale a pour objectif ultime de transformer la société en lieu de permutation où plus une seule différence ne subsisterait dans un champ d’indifférence radicale à l’humain…
Puissions nous éviter un si funeste destin.
- Université : Opération « Écrans noirs » du vendredi 13 au mardi 17 — 13 novembre 2020
- Tribune dans Le Monde : « Les libertés sont précisément foulées aux pieds lorsqu’on en appelle à la dénonciation d’études et de pensée » — 4 novembre 2020
- Pandémie et solidarités: associations et collectifs citoyens à bout de souffle sonnent l’alarme — 13 mai 2020
